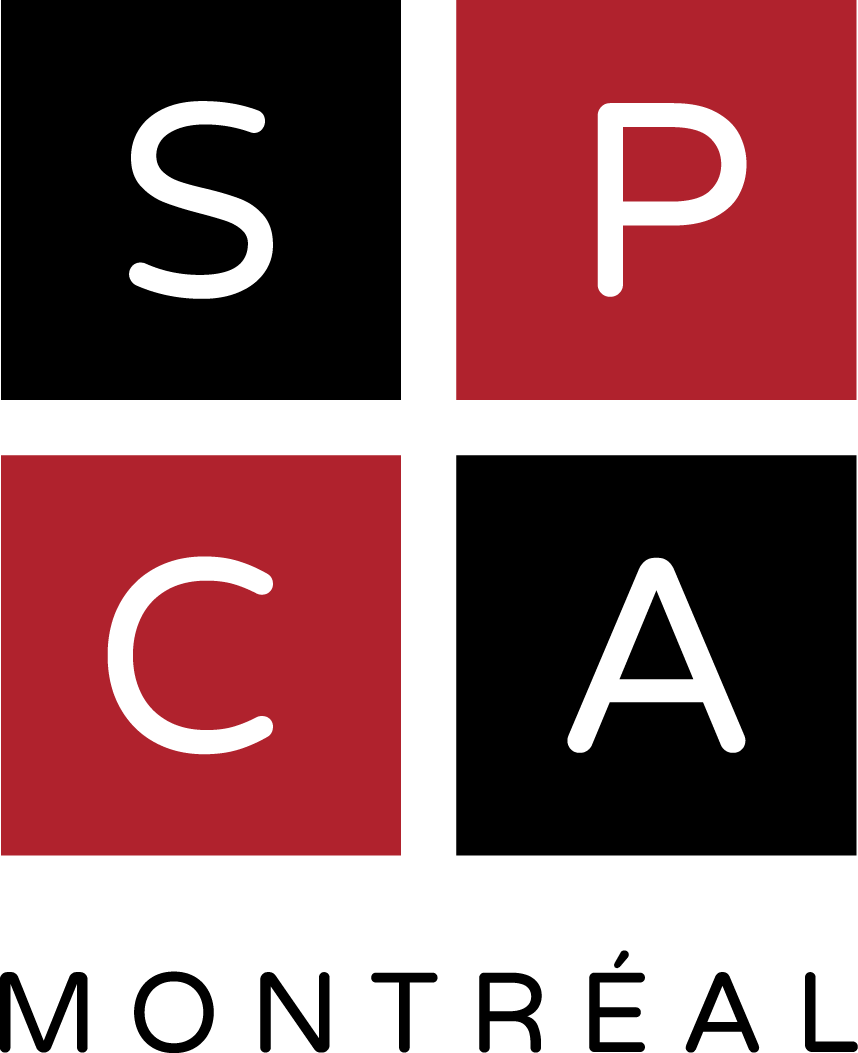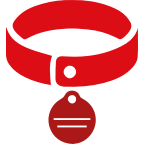Crédits photo : Jo-Anne McArthur / We Animals
Signez pour soutenir des méthodes alternatives éthiques, modernes et efficaces à l'expérimentation animale
Devrait-on éviter les tests douloureux sur les animaux
chaque fois qu’une alternative efficace existe?
83 % des Canadien·ne·s pensent que oui¹.
Chaque année, plus de 3 millions d’animaux, notamment des chiens, des chats, des primates, des rats, des souris, des poissons, des amphibiens, des reptiles, des lapins et des bovins, sont utilisés au Canada à des fins de recherche scientifique et de tests de toxicité. Ces animaux sont parfois soumis à des souffrances physiques et psychologiques importantes tout en étant privés d’un milieu vie stimulant et de la possibilité d’exprimer leurs comportements naturels.
Crédits photos : Carlota Saorsa / Jo-Anne McArthur / We Animals et PETA US
L’utilisation des animaux dans les laboratoires est-elle encore une pratique courante?
L’utilisation d’animaux dans les laboratoires est toujours largement répandue au Canada. Selon le plus récent rapport du Conseil canadien de protection des animaux (CCPA), plus de 3,7 millions d’animaux ont été utilisés à des fins de recherche, d’enseignement ou de tests réglementaires en 2024. Plusieurs types d’animaux sont susceptibles d’être utilisés, soit des souris, des poissons, des rats, des oiseaux, des animaux de ferme, des amphibiens, des lapins ainsi que des chiens et des chats. Environ un million d’entre eux ont été soumis à des procédures causant une douleur ou détresse modérée à sévère.
Les tests sur les animaux s’avèrent coûteux et d’une efficacité variable pour prédire les effets sur la santé humaine et sur l’environnement.
Seulement 5 % des approches thérapeutiques testées sur les animaux sont finalement approuvées pour une utilisation sécuritaire chez les humains². Ce faible taux de succès peut retarder l’accès à des traitements en santé humaine.
Heureusement, des solutions à la fine pointe de la technologie existent. La science moderne offre des options d’une efficacité redoutable, comme l’utilisation d’organes sur puce et de tissus bio-imprimés en 3D en plus du recours à l’intelligence artificielle. Ces options n’impliquent pas de souffrance animale et reproduisent fidèlement la biologie humaine³.
La SPCA de Montréal estime que tout doit être mis en œuvre pour remplacer l’utilisation d’animaux dans les laboratoires dès qu’une méthode aussi efficace, ou meilleure, existe.
Bien que le Canada se soit engagé en 2022 à réduire l’expérimentation animale pour l’évaluation de la toxicité des produits, la stratégie annoncée en 2025 ne prévoit ni objectifs chiffrés, ni échéanciers, ni financement dédié. Pendant ce temps, la France et les États-Unis investissent massivement dans des solutions de pointe visant à remplacer ou réduire l’utilisation des animaux⁴.

Crédits photo : PETA US
Pourquoi utilise-t-on encore des animaux s’il existe des méthodes alternatives éthiques?
Même si des technologies modernes et éthiques existent, on continue malheureusement d’utiliser un grand nombre d’animaux en science et en toxicologie parce que le système est encore largement structuré autour de protocoles et de financements qui privilégient les expérimentations animales. De plus, malgré l’existence de méthodes alternatives de pointe, l’adoption de ces dernières reste freinée par le manque de financement ciblé, par les habitudes institutionnelles et par la lente validation réglementaire de ces approches. Enfin, les décideurs peuvent continuer à recourir aux animaux parce que les infrastructures et les normes favorisant leur utilisation sont déjà en place, ce qui rend le changement plus lent que ce que les progrès technologiques eux-mêmes permettraient.
Crédits photo : Jo-Anne McArthur / We Animals

Demandons au gouvernement fédéral de tout mettre en œuvre pour que les méthodes alternatives à l’utilisation des animaux en science deviennent la norme au Canada.
Des millions d’animaux vous remercient!
* N’oubliez pas de confirmer votre signature en répondant au courriel que vous recevrez après avoir signé.
Crédits photo : Lukas Vincour / Zvirata Nejime / We Animals
En apprendre plus
L’utilisation d’animaux dans les laboratoires est toujours largement répandue au Canada. Selon le plus récent rapport du Conseil canadien de protection des animaux (CCPA), plus de 3,7 millions d’animaux ont été utilisés à des fins de recherche, d’enseignement ou de tests réglementaires en 2024. Plusieurs types d’animaux sont susceptibles d’être utilisés, soit des souris, des poissons, des rats, des oiseaux, des animaux de ferme, des amphibiens, des lapins ainsi que des chiens et des chats. Environ un million d’entre eux ont été soumis à des procédures causant une douleur ou détresse modérée à sévère.
Les universités et centres de recherche publics ont recours à l’expérimentation animale pour la recherche. Les entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et chimiques s’en servent pour tester la sécurité ou l’efficacité de nouveaux médicaments et produits. On retrouve aussi de nombreux laboratoires contractuels privés qui réalisent des essais réglementaires pour le compte d’autres compagnies.
Les manipulations, contention et procédures invasives auxquelles sont régulièrement soumis les animaux de laboratoire causent des souffrances physiques, psychologiques et émotionnelles considérables aux animaux : douleur, peur, détresse, privation, immobilisation et mort.
Parmi les pratiques dans les catégories les plus invasives, on retrouve :
- des procédures perturbant le système sensoriel et moteur de façon sévère, persistante ou irréversible;
- l’administration de médicaments ou de substances chimiques à des concentrations qui perturbent le fonctionnement des systèmes physiologiques de façon marquée et qui provoquent la mort, des douleurs intenses ou une détresse extrême;
- la privation environnementale pouvant compromettre gravement le bien-être de l’animal;
- l’emploi de relaxants musculaires ou de médicaments paralysants sans anesthésie;
- des brûlures ou traumatismes infligés à un animal non anesthésié et des procédures causant une douleur au seuil de tolérance et qui ne peut être soulagée par des analgésiques;
- l’extraction de dents sans analgésie;
- des tests de toxicité ainsi que des maladies infectieuses induites expérimentalement et se terminant par la mort.
Au-delà des procédures comme telles, les conditions de vie des animaux sont problématiques sur le plan du bien-être. En effet, les animaux sont typiquement gardés en cage toute leur vie, dans des environnements appauvris. Alors que la liberté d’exprimer des comportements naturels et la possibilité de vivre des expériences positives sont reconnues comme étant essentielles au bien-être animal, les animaux de laboratoire sont généralement privés de ces possibilités en raison de leurs conditions de garde.
L’utilisation d’animaux sauvages en recherche pose aussi problème. Ces animaux n’étant pas adaptés aux interactions avec des êtres humains, leur utilisation en recherche ou leur maintien en captivité compromet nécessairement et gravement leur bien-être.
Le cadre juridique actuel est largement insuffisant pour assurer le bien-être des animaux utilisés en recherche et dans le cadre de tests de toxicité. Tout d’abord, aucune loi fédérale n’encadre comment ces animaux peuvent être traités dans les laboratoires.
Ensuite, au niveau provincial, les animaux sauvages utilisés en recherche, par exemple les primates, sont exclus des principales protections prévues au Règlement sur les animaux en captivité du moment que leurs conditions de garde et d’utilisation aient été approuvées par un établissement qui détient un « certificat de bonnes pratiques » du Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) en science. Or, la certification de bonnes pratiques animales offerte par le CCPA consiste en un processus d’évaluation par les pairs en vertu duquel une visite des installations est effectuée aux trois ans, avec préavis, en vue de s’assurer de la conformité aux lignes directrices. De plus, aucune mesure punitive n’est prévue en cas de non-conformité pour les institutions financées par des fonds privés qui choisissent volontairement de se soumettre au programme de certification.
Pour ce qui est de l’utilisation des animaux de compagnie, comme les chats, les chiens et les lapins, bien que la réglementation provinciale rende obligatoire l’application des lignes directrices du CCPA, celles-ci sont largement insuffisantes pour garantir le bien-être des animaux. En effet, même si les lignes directrices du CCAC incitent à se conformer à des standards minimaux, elles visent surtout à assurer une certaine conformité administrative et non pas à interdire des pratiques douloureuses ou hautement invasives.
Les principales méthodes alternatives et éthiques à l’expérimentation animale sont les méthodes dites « non animales », comme le recours aux organes sur puce, aux tissus bio-imprimés en 3D et à la modélisation informatique. Ces méthodes reproduisent fidèlement la biologie humaine parce qu’elles impliquent l’emploi de cellules et de tissus humains réels plutôt que ceux d’animaux, dont la physiologie diffère souvent de la nôtre.
Les organes sur puce, par exemple, recréent les conditions microphysiologiques (circulation sanguine, respiration, interactions cellulaires) d’un organe humain, ce qui permet d’observer des réactions proches de celles du corps humain.
Les tissus bio-imprimés en 3D, de leur côté, consistent en des tissus humains qui sont fabriqués en déposant couche par couche un mélange de cellules vivantes et de biomatériaux appelé « bio-encre ». Ces tissus reproduisent la structure et les fonctions d’organes humains, comme la peau ou les vaisseaux sanguins, et permettent de tester des médicaments ou des produits chimiques. Ainsi, ces technologies offrent des résultats précis et transposables à la santé humaine, tout en évitant la souffrance animale.
Oui, il est possible de privilégier des alternatives à l’expérimentation animale sans freiner les progrès scientifiques. Les méthodes utilisant des animaux sont souvent coûteuses et de fiabilité variable, car les résultats obtenus sur les animaux ne se traduisent pas toujours fidèlement chez l’humain en raison de différences génétiques, métaboliques et physiologiques importantes entre les espèces. De nombreuses approches thérapeutiques testées sur des animaux ont échoué à prédire des effets réels ou des risques sur la santé humaine, ce qui soulève des questions quant à l’efficacité et à la sécurité de ces pratiques.
La thalidomide, par exemple, a provoqué de graves malformations congénitales chez des milliers d’enfants avant son retrait du marché. Pourtant, les tests effectués sur des rats, lapins, chiens, hamsters, primates, chats, tatous, cobayes, porcs et furets n’avaient révélé aucun effet tératogène significatif. Ces limites renforcent la nécessité d’investir dans des méthodes de recherche plus pertinentes et directement applicables à la santé humaine. Il est assurément possible de réduire l’utilisation actuelle des animaux en recherche. Éventuellement, cette pratique devra être considérée comme un dernier recours, justifiée uniquement lorsque des conditions médicales graves et débilitantes sont en jeu et qu’aucune méthode alternative n’existe.
Les méthodes alternatives modernes, comme les organes sur puce, les recherches sur cellules humaines et les modèles informatiques, utilisées dans certains domaines, offrent des données plus pertinentes et précises que celles résultant de tests sur des animaux. En plus d’être plus éthiques, ces approches peuvent accélérer les découvertes scientifiques. Elles représentent donc un moyen de faire progresser la science tout en épargnant les animaux.
Même si des technologies modernes et éthiques existent, on continue malheureusement d’utiliser un grand nombre d’animaux en science et en toxicologie parce que le système est encore largement structuré autour de protocoles et de financements qui privilégient les expérimentations animales. De plus, malgré l’existence de méthodes alternatives de pointe, l’adoption de ces dernières reste freinée par le manque de financement ciblé, par les habitudes institutionnelles et par la lente validation réglementaire de ces approches. Enfin, les décideurs peuvent continuer à recourir aux animaux parce que les infrastructures et les normes favorisant leur utilisation sont déjà en place, ce qui rend le changement plus lent que ce que les progrès technologiques eux-mêmes permettraient.
Signez pour soutenir des méthodes alternatives éthiques, modernes et efficaces à l'expérimentation animale
Sources :
¹ Sondage Léger Marketing effectué du 19 au 21 septembre 2025 auprès de 1 521 Canadien·ne·s. Au Québec, le même sondage indique que 88% des Québécois·es estiment qu’on doit toujours privilégier une alternative scientifique moderne aux tests douloureux sur les animaux, lorsqu’elle existe.
² Ineichen, B. V., Furrer, E., Grüninger, S. L., Zürrer, W. E., Macleod, M. R., (2024), « Analysis of animal-to-human translation shows that only 5% of animal-tested therapeutic interventions obtain regulatory approval for human applications », PLoS Biol 22(6): e3002667, https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002667.
³ Srivastava, S. K., Foo, G. W., Aggarwal, N., Chang, M. W., (2024) « Organ-on-chip technology: Opportunities and challenges », Biotechnology Notes, Volume 5, Pages 8-12, ISSN 2665-9069, https://doi.org/10.1016/j.biotno.2024.01.001 ; Sun, X., Ren, W., Xie, L., Ren, Q., Zhu, Z., Jia, Q., Yu, Y. , (2024), « Recent advances in 3D bioprinting of tissues and organs for transplantation and drug screening, Virtual and Physical Prototyping, 19(1), https://doi.org/10.1080/17452759.2024.2384662.
⁴ U.S. Food and Drug Administration (FDA), (2023). Roadmap to reducing animal testing in preclinical safety studies. U.S. Department of Health and Human Services. https://perma.cc/6XFP-8DCR ; Agence nationale de la recherche (ANR). (2024). « Organes et organoïdes sur puces (MED-OOC) — Programme et équipements prioritaires de recherche (PEPR) ». France 2030. https://perma.cc/B7DM-VVG2.